Grandir, vieillir : le traitement du langage tout au long de la vie
Le langage évolue avec l’âge, mais il ne suit pas une trajectoire linéaire.
Des premiers changements des capacités perceptives, avant même le début du babillage aux modifications liées au vieillissement, EFL explore les transformations dans le traitement du langage en perception et en production, à chaque étape de la vie, en croisant linguistique, psychologie, neurosciences, phonologie et phonétique clinique. Une plongée dans les bases cognitives, la plasticité cérébrale et les mécanismes de la communication humaine.

Mesure pour comprendre.
La thématique mène de nombreuses expériences pour comprendre le langage à tous les âges de la vie.
Co-responsables :
Thierry Nazzi (INCC – CNRS/Université Paris Cité)
Cécile Fougeron (LPP – CNRS/Sorbonne Nouvelle)
Un axe central pour comprendre le langage comme processus vivant
L’acquisition du langage commence à un très jeune âge, depuis la naissance, voire depuis le dernier trimestre de gestation. Les connaissances langagières et la façon dont elles sont traitées, ainsi que les compétences motrices pour produire le langage se transforment et s’adaptent ensuite tout au long de la vie. Les premières acquisitions langagières sont mises en évidence à travers des changements dans la façon dont le langage est perçu, et dans les premières productions des enfants, observables pendant la première année. Elles se consolident pendant l’enfance et évoluent à l’âge adulte et se modifient avec le vieillissement. Ces acquisitions et changements touchent tous les niveaux de langage, les sons de parole, les mots et les structures grammaticales de la langue maternelle ou des langues maternelles chez les enfants bi- ou pluri-lingues.
Ces évolutions peuvent suivre des trajectoires naturelles, typiques, mais aussi des trajectoires atypiques. En effet, si la plupart des enfants acquièrent le langage sans problèmes, d’autres enfants manifestent certaines difficultés, liées à des troubles ou des conditions de développement particulières. De même, à l’âge adulte, le langage s’adapte et évolue naturellement avec le vieillissement, mais parfois des troubles physiologiques ou neurologiques (moteurs et/ou cognitifs) peuvent en altérer le bon fonctionnement.
L’objectif de cet axe est de comprendre les mécanismes cognitifs et moteurs, ainsi que leurs bases cérébrales, qui façonnent notre capacité linguistique à travers les âges, et de documenter les trajectoires typiques comme atypiques du développement langagier et de son évolution au cours de la vie.
Questionnements scientifiques de la thématique
-
Comment le langage est acquis dans la petite enfance, en fonction de la ou des langue(s) maternelle(s) ?
- Développement des capacités de traitement phonologique, syntaxique et sémantique en perception
- Développement de la parole parlée
- Rôle des interactions sociales précoces dans l’acquisition du langage
- Etudes sur les troubles dans l’acquisition du langage
Comment le cerveau du jeune enfant traite-t-il le langage ?
- Mise en place des systèmes de traitement du langage
- Rôle de la plasticité dans le fonctionnement cérébral précoce
Quels facteurs cliniques influencent l’acquisition précoce du langage ?
- Effet de la surdité, et de l’implantation cochléaire
- Impact de la prématurité
Comment le traitement du langage évolue-t-il avec l’âge chez l’adulte et avec le vieillissement?
- Maturation, évolution, et effets des changements physiologiques, hormonaux, cognitifs et sociaux sur nos capacités linguistiques
- Flexibilité et adaptation, processus compensatoires mis en place par le cerveau (plasticité)
Quels sont les signes précoces de troubles cognitifs et moteurs dans le langage ?
- Caractérisation et différenciation des troubles de la parole et du langage liés à la pathologie (Alzheimer, Maladie de Parkinson, AVC…)
- Utilisation de la parole et du langage comme biomarqueur non invasif dans certains troubles neurologiques
Méthodologies déployées
Le projet mobilise un large spectre de méthodes intégrées :
- Expériences comportementales : évaluation de la perception, de la compréhension, de la production, de la mémoire verbale
- Neuroimagerie (EEG, NIRS, …) : observation de l’activité cérébrale au cours de tâches linguistiques
- Phonétique acoustique et articulatoire : analyse fine de la parole et quantification des troubles éventuels, chez des locuteurs de tous âges
- Corpus longitudinaux : suivi d’individus sur plusieurs années pour observer l’évolution langagière
- Analyses comparatives : entre âges, entre langues, entre populations sans ou avec difficultés langagières
Applications et retombées concrètes
- Éducation : meilleure compréhension des trajectoires d’acquisition du langage pour adapter les méthodes pédagogiques.
- Médecine et neuropsychologie : identification de marqueurs linguistiques pour le diagnostic précoce.
- Technologie : amélioration des aides à la communication (IA, interfaces vocales adaptées au vieillissement).
- Politique de santé publique : sensibilisation à l’importance du langage comme facteur de bien-être mental et social.
Partenariats
- Travaux menés en lien avec les unités INCC (Integrative Neuroscience and Cognition Center), LLF (Laboratoire de Linguistique Formelle), ALTAE (Approches Linguistiques Théoriques, Appliquées et Expérimentales) et le LPP (Laboratoire de Phonétique et Phonologie).
- Approche transversale intégrant la psycholinguistique développementale, la neurolinguistique et la linguistique formelle. la phonétique et la phonologie, la phonétique clinique
- Collaboration étroite avec les écoles doctorales et masters spécialisés (PGSL, Cog-SUP, ED661, ED3C).
En résumé
L’axe « Grandir, vieillir » du projet EFL vise à comprendre comment le langage est acquis et utilisé depuis la naissance et tout au long de la vie, pour mieux comprendre ses variations et possibles dysfonctionnements – et pour concevoir demain des outils, des politiques et des pratiques plus respectueuses de la diversité des situations langagières.
À lire aussi

Lancement du séminaire de métagrammaticographie : comprendre comment on décrit les langues
Yvonne Treis et Aimée Lahaussois, chercheuses au laboratoire HTL (Histoire des théories linguistiques), lancent un nouveau séminaire consacré à la métagrammaticographie dans le cadre du projet EFL

Langues et mobilité urbaine en Amérique latine : séminaire avec Juan Carlos Godenzzi
Le 17 février 2026, le WP6 “Language in its social context” accueille Juan Carlos Godenzzi (Université de Montréal) pour une conférence sur les dynamiques linguistiques dans trois capitales sud-américaines
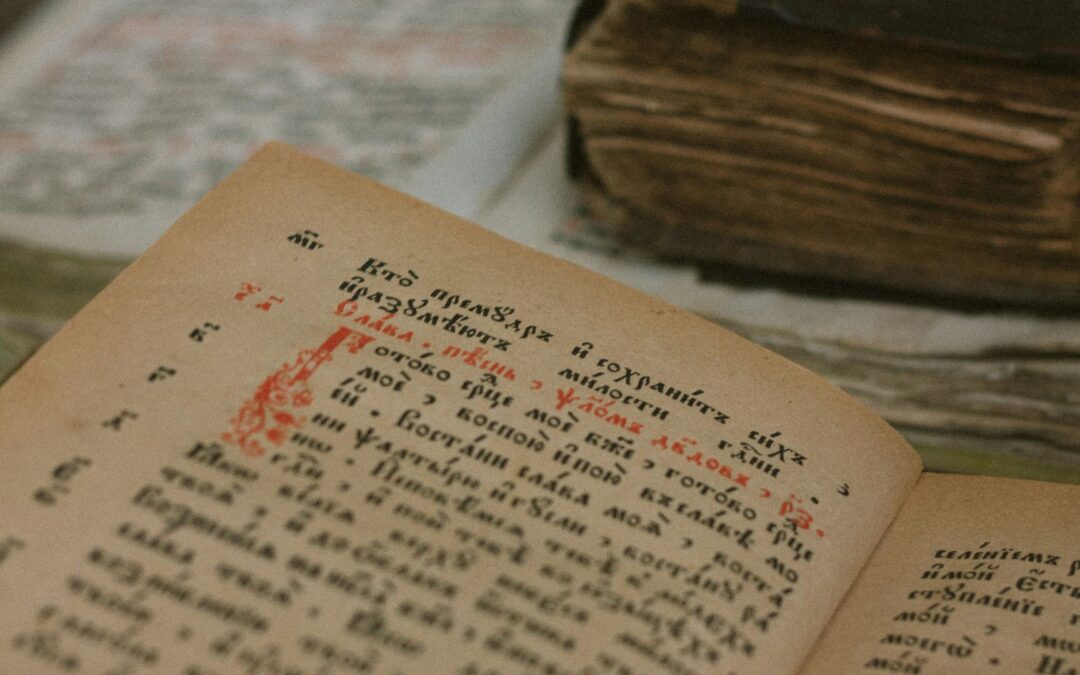
Lancement d’un séminaire sur les paradigmes en histoire de la linguistique
Le laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques (HTL) lance un nouveau cycle de recherche en collaboration avec le projet inIdEx EFL. Intitulé “Les paradigmes. Histoire et épistémologie”

Prix Science Ouverte 2025 : Qumin récompensé pour la linguistique computationnelle
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a décerné son Prix du logiciel libre de recherche 2025 à Qumin, développé par Sacha Beniamine (ancien doctorant EFL) et Jules Bouton (doctorant EFL).
